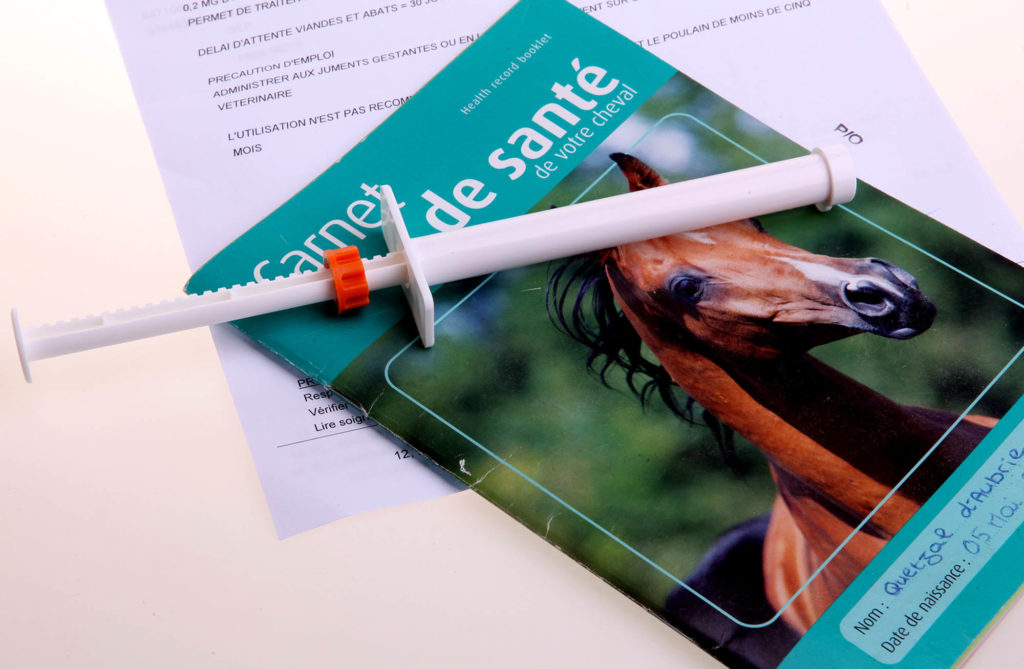Le Syndrome Métabolique Équin est une maladie de plus en plus représentée, qui affecte les chevaux, en particulier au cours du printemps. Dysfonction du système métabolique, les symptômes sont néanmoins souvent révélateurs et l’animal souffrant de cette pathologie doit faire l’objet de soins spécifiques.
Qu’est-ce que le métabolisme ?
Comme son nom l’indique, le Syndrome Métabolique Équin est une pathologie qui touche le métabolisme.
Le métabolisme correspond à l’ensemble des mécanismes cellulaires qui vont faire fonctionner correctement un organisme, en lui fournissant les moyens et l’énergie nécessaires pour :
- assimiler son alimentation et utiliser les nutriments,
- se déplacer,
- se reproduire,
- ou encore pour s’adapter à son environnement et réagir aux situations qui se présentent.
Il regroupe donc de multiples réactions chimiques, qui vont permettre à l’animal d’atteindre un équilibre malgré les variations et les évènements qu’il va rencontrer tout au long de sa vie.
Vous l’aurez compris, le moindre défaut dans le processus métabolique peut avoir un impact considérable sur la santé.
Alimentation et métabolisme
L’alimentation constitue l’un des piliers les plus importants du métabolisme chez l’animal, car il lui permet de récupérer les éléments essentiels à sa survie.
Parmi les nutriments, les sucres sont indispensables au bon fonctionnement d’un organisme et plus particulièrement du cerveau. Cependant, leur régulation (grâce au métabolisme) est primordiale, afin que leur utilisation soit optimale, mais aussi pour soutenir l’ensemble des organes et la survie de l’animal.
Le glucose est une source d’énergie : il peut être employé immédiatement ou bien stocké dans les muscles, le foie ou encore les tissus adipeux (graisse).
Ces processus sont gérés par une succession de réactions chimiques faisant partie du métabolisme et induisant par conséquent des variations de la glycémie : le taux de glucose dans le sang va en effet être important après avoir mangé, et réduire lorsque les sucres seront utilisés ou emmagasinés.
La régulation de la glycémie est conditionnée par la présence d’une hormone produite par le pancréas : l’insuline. Celle-ci va entraîner :
- l’absorption du glucose dans les cellules, afin de leur donner de l’énergie immédiatement,
- le stockage du glucose au sein de certains organes (le foie et les muscles).
Quelles sont les causes du Syndrome Métabolique Équin ?
Le Syndrome Métabolique Équin (ou SME) est lié à une dysfonction du rôle de l’insuline : l’alimentation du cheval joue donc un rôle prépondérant.
Une insulinorésistance
Lorsque l’animal s’alimente, son pancréas produit de l’insuline en réponse à l’arrivée et la détection de sucres dans le sang. Mais dans le cas du SME, celle-ci a un effet très réduit : on parle d’insulinorésistance.
Le glucose va alors rester présent en quantité importante dans le sang (on observera une hyperglycémie) et le pancréas va continuer de sécréter de l’insuline pour pallier à ce phénomène (entraînant aussi une hyperinsulinémie).
Les cellules ayant besoin d’un apport énergétique dans l’instant n’en auront pas suffisamment, le cycle de stockage dans le foie et les muscles va être limité et par conséquent les sucres vont être conduits vers les tissus graisseux : à la longue, le cheval va donc prendre du poids et être moins actif.
L’obésité a une conséquence directe sur l’insulinorésistance : en effet, la charge en graisse dans les tissus adipeux provoque une inflammation systémique qui tend à accentuer la résistance à l’insuline. Aussi, le SME entraîne une forme de cercle vicieux qu’il est essentiel de contrer, en prévenant et en réduisant l’obésité chez l’équidé atteint.
L’origine du Syndrome Métabolique Équin
On ne connaît pas très bien l’origine du SME chez l’équidé, mais il est évident que certains individus y sont prédisposés, comme le poney Shetland ou les races ibériques. Cette pathologie se développe surtout chez les chevaux âgés de 5 à 15 ans.
D’autres facteurs, comme une alimentation trop riche ou encore le manque d’activité physique semblent aussi jouer dans la survenue de cette maladie. D’ailleurs, les cas surgissent principalement lorsque l’herbe est la plus grasse (en particulier au printemps et quelques fois à l’automne).
Les symptômes et le diagnostic du Syndrome Métabolique Équin
Les symptômes du Syndrome Métabolique Équin sont très reconnaissables. Le cheval va en effet présenter un surpoids important et des dépôts de graisse quelques fois conséquents notamment au niveau de l’encolure. Il peut aussi souffrir d’épisodes de fourbures douloureuses.
Les juments montrent une baisse de la fertilité et globalement l’équidé sera moins énergique.
Afin de confirmer le diagnostic, le vétérinaire peut faire une prise de sang et analyser les taux de sucres et d’insuline. Il peut également réaliser un test d’assimilation du glucose.
Puis-je guérir mon cheval atteint du SME ?
Malheureusement, il n’existe pas de traitement pour le moment pour guérir un cheval souffrant de SME.
Cependant, il est possible d’adapter son environnement, son alimentation et son travail afin de l’aider à supporter au mieux les symptômes de cette pathologie et à en réduire les conséquences.
Vous pouvez privilégier une source de nourriture peu nutritive, comme du foin de graminées éventuellement récolté sur un stade avancé. Il est préférable de lui limiter l’accès à l’herbe durant les saisons les plus à risques (printemps et automne), car la végétation y est riche en sucre. Aussi, évitez de lui donner tout type de céréales et de produits contenant de l’amidon.
Il est également essentiel de rétablir un exercice régulier pour favoriser la perte de poids, de réduire la réaction inflammatoire liée à l’accumulation de graisses, afin d’améliorer sa sensibilité à l’insuline. Cependant, en raison de la potentialité des crises de fourbure, la reprise d’une activité physique peut être complexe à mettre en pratique : il est primordial d’adapter la demande aux possibilités de son animal.
Certains traitements médicaux peuvent éventuellement aider votre cheval. C’est le cas des produits anti-hyperglycémiants (comme la metformine) qui vont permettre de réduire le taux de sucre dans le sang.
Assurer son cheval pour réduire les frais vétérinaires
Vous avez des questions sur nos offres d’assurances équestres ? L’équipe d’Equitanet est à votre écoute pour vous orienter vers la formule de garanties la plus appropriée pour vous et votre équidé. N’oubliez pas que souscrire à une assurance pour son compagnon permet la prise en charge de nombreux frais vétérinaires, qui peuvent quelques fois constituer des sommes très importantes. Cela vous offre la possibilité de faire face plus facilement aux aléas de la vie avec un cheval ! N’hésitez pas à nous contacter pour un devis personnalisé.